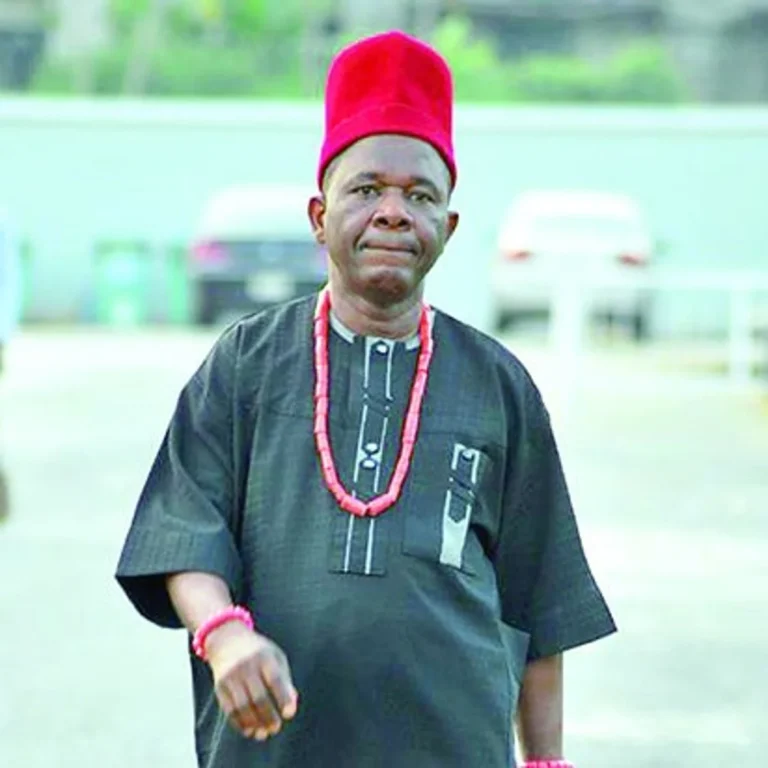Par Khaled Boulaziz – Il y a des pays qui vivent, et il y en a qui simulent la vie par le vacarme. Le Maroc, depuis qu’il s’est agenouillé devant Tel-Aviv en échange de drones et de mirages diplomatiques, ne respire plus par ses institutions, mais par les colonnes toxiques de ses «journalistes» enragés. La monarchie a troqué la dignité contre la servitude, et dans ce pacte funeste, elle a trouvé un os à ronger : l’Algérie. Mais voilà que l’obsession algérienne ne leur suffit plus. Après avoir vomi leur haine sur les frontières algéro-marocaines à chaque lune, ils s’inventent désormais une croisade nouvelle : les frontières algéro-libyennes, comme si la géographie du Maghreb devait obéir aux fantasmes cartographiques d’un royaume occupé mentalement.
Les rédactions du royaume se sont transformées en ateliers de cartographie délirante. On n’y parle plus d’économie, de pauvreté galopante, de jeunesse étranglée par le chômage ; on y trace des lignes imaginaires sur la carte d’Afrique du Nord comme un enfant fiévreux qui redessine le monde pour supporter sa propre insignifiance. Qu’importe que les frontières algériennes aient été reconnues par le droit international, inscrites dans le sang de ceux qui ont combattu la colonisation. Non. Pour ces scribes du Makhzen, il faut sans cesse rouvrir la plaie, ressasser la fiction de terres «volées», «annexées», «spoliées». Le lexique est toujours le même, pavlovien, recraché comme un catéchisme de cour.
Mais voici désormais un paradoxe grotesque : la presse marocaine ne se contente plus de contester l’Algérie pour son propre compte, ce qui serait déjà pathologique ; elle se permet maintenant de parler au nom de la Libye, exigeant que ce pays rediscute ses frontières avec l’Algérie, comme si Rabat se rêvait soudain procureur géopolitique du Maghreb. Nous voilà donc face à un royaume incapable de régler ses propres fractures internes, mais qui se donne la mission messianique de redistribuer les cartes de la région. C’est la folie impériale sans empire, l’arrogance coloniale sans armée, le délire cartographique sans légitimité.
Cette stratégie médiatique n’est pas un hasard. Elle est le prolongement logique d’une soumission géopolitique. Depuis que le Makhzen a accueilli à bras ouverts les officiers israéliens, leurs bases, leurs instructeurs, leur intelligence électronique, il lui fallait un langage de guerre pour justifier cette occupation diplomatique. Quel meilleur ennemi que l’Algérie, cette voisine rétive, insoumise, irréductible ? Mais l’Algérie ne réagit pas. Elle ne rentre pas dans le spectacle. Alors le royaume s’enfonce plus loin dans la fiction, ajoute des lignes, invente des dossiers, élargit l’hystérie : après Tindouf, voilà Ghadamès ; après Béchar, voilà la frontière libyenne. Chaque nouveau «contentieux» inventé devient une offrande faite à Tel-Aviv, une preuve de loyauté de plus : «Voyez, maîtres, combien nous haïssons Alger.»
Cette presse, si l’on ose encore utiliser ce mot, n’informe plus : elle fabrique du ressentiment à la chaîne, comme on emballe une marchandise de contrebande. Elle ne parle jamais du Maroc réel, celui des bidonvilles entourant Casablanca, des jeunes brûlés par le harcèlement policier, des petits marchands battus pour avoir occupé un trottoir, des prisonniers politiques enfermés pour un post Facebook. Non. Le Maroc réel est sacrifié sur l’autel du Maroc imaginaire, celui des cartes infiniment expansibles, tracées non sur le terrain mais dans la fièvre des rédactions sous perfusion.
Et pendant que ces «géographes possédés» redessinent le Sahara, Tindouf, Djanet et désormais la frontière libyenne, le peuple marocain, lui, ne possède pas même la cartographie de son propre destin. On lui dit que l’Algérie le menace, que la Libye a été «trompée», que le Maghreb lui doit des comptes. Mais ce discours n’est pas patriotique : il est la signature même de la servitude. Le souverain se reconnaît à sa capacité de tracer ses propres frontières intérieures, symboliques, de décider de son horizon. Le vassal, lui, parle sans cesse des frontières des autres.
Face à cette hystérie cartographique, l’Algérie demeure droite, silencieuse, presque indifférente. Elle n’a pas besoin de hurler sa souveraineté : elle l’a conquise dans la douleur, elle l’a inscrite dans la chair de l’histoire. Ses frontières ne sont pas un fantasme imprimé dans un tabloïd, elles sont un tombeau collectif, une ligne de feu traversée par les martyrs de 1954. Aucun éditorialiste subventionné ne pourra dissoudre cela dans l’encre de ses haines.
Qu’ils tracent donc. Qu’ils inventent. Qu’ils se perdent dans leurs cartes comme on se perd dans un labyrinthe mental.
Le Maroc occupé peut bien prétendre redessiner le Maghreb, il ne parvient même plus à dessiner son propre avenir.
K. B.