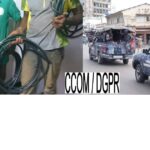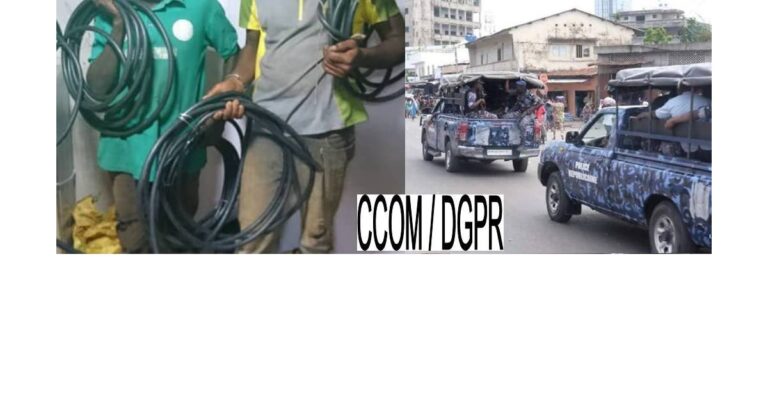Dans un monde marqué par le retour des empires et des puissances civilisationnelles, la géopolitique mondiale retrouve les grandes logiques historiques que la colonisation et la guerre froide avaient gelées. La Russie, la Chine, la Turquie, l’Iran ou encore l’Inde reconstituent leurs sphères d’influence naturelles. Et dans ce nouvel ordre multipolaire, le Maroc, fort d’une continuité́ étatique de plus de douze siècles, s’impose comme une puissance d’équilibre et de stabilité́. Face à ce bouleversement, une idée s’impose avec de plus en plus de cohérence : et si le Maroc renouait avec son espace d’influence originel, à travers une fédération avec la Mauritanie, sœur jumelle historique et spirituelle ?
Un héritage effacé par la colonisation, mais pas oublié
Avant la Conférence de Berlin de 1884, le Maroc chérifien exerçait une souveraineté́ effective et reconnue sur un immense espace saharien, s’étendant jusqu’à la vallée du fleuve Sénégal et du Mali. Les tribus du Trarza, Brakna, Adrar et Tagant prêtaient la bay‘a au Sultan du Maroc. Les liens religieux, linguistiques et commerciaux faisaient de la Mauritanie actuelle un prolongement naturel du Maroc originel. Mais la Conférence de Berlin, tenue sans le Maroc, et qui fut pourtant un État reconnu internationalement par ses pairs, livra cet espace à la convoitise coloniale : l’Espagne s’empara du Sahara atlantique (Rio de Oro, Saguia el-Hamra) et la France annexa la Mauritanie chérifienne et le Sahara oriental (Touat, Gourara, Tidikelt) au profit de l’Algérie coloniale. Ainsi, le Maroc perdit les deux tiers de son territoire d’influence historique — un morcellement dont les effets se ressentent encore aujourd’hui.
Le Maroc, une continuité́ historique incarnée par le Trône
Le Maroc est le seul État africain à avoir conservé́ la même dynastie, la même légitimité́ religieuse et la même identité́ nationale depuis plus de 12 siècles. Sous la conduite du Trône alaouite, le Royaume a progressivement restauré son intégrité́ territoriale : Tarfaya en 1958, Ifni en 1969, et le Sahara marocain en 1975 grâce à la Marche Verte initiée par Sa Majesté́ le Roi Hassan II, prolongeant la vision du Sultan Mohammed V, artisan de l’indépendance et symbole de l’unité́ retrouvée. Cette continuité́ politique et spirituelle du Trône a toujours guidé la défense du Maroc chérifien. Comme le rappelait Allal El Fassi, « Le Maroc intégral est une vérité́ historique avant d’être une revendication politique. » Cette pensée illustre la fidélité́ du Royaume à ses racines africaines, sahariennes et atlantiques. Aujourd’hui, la reconnaissance du plan d’autonomie marocain par de nombreuses puissances, et l’ouverture de plus de trente consulats à Laâyoune et Dakhla, confirment que le Maroc a repris la place qui lui revient dans son espace géopolitique naturel : celui du Maghreb atlantique et du Sahel pacifié.
Une fédération Maroc–Mauritanie : entre héritage et avenir
L’idée d’une fédération entre le Maroc et la Mauritanie n’est ni expansionniste ni nostalgique : elle est civilisationnelle, rationnelle et mutuellement bénéfique.
Des racines communes solides
Une langue et une culture partagées, nourries de la même identité́ arabo-amazigh et saharienne. Le rite malékite et la tradition soufie unissant Fès, et Chinguetti. Un héritage religieux fondé sur la modération et la sagesse spirituelle.
Des intérêts stratégiques convergents
Un axe atlantique unifié reliant Tanger, Dakhla et Nouakchott, pivot du commerce ouest-africain. La sécurisation du flanc sud du Maghreb, confronté aux menaces terroristes du Sahel. Une complémentarité́ économique naturelle : industrie et logistique au nord, ressources minières et énergétiques au sud. Et une voix africaine unie sur les grands dossiers diplomatiques et économiques.
Une union d’égal à égal, respectueuse de la souveraineté́
Toute perspective d’union ou de fédération ne remettrait en aucun cas en cause la pleine souveraineté́ de la République islamique de Mauritanie ou celle du Royaume du Maroc. Au contraire, elle en renforcerait la portée et la sécurité́ mutuelle. Il ne s’agirait pas d’une fusion politique, mais d’une alliance de deux États indépendants, décidés à conjuguer leurs forces autour de projets concrets : la coopération économique, la défense commune, la gestion concertée de l’espace atlantique, et la valorisation spirituelle et culturelle commune.
Conclusion : un projet de civilisation et d’équilibre
Le Maroc n’a pas à inventer un nouvel empire : il lui suffit de retrouver l’esprit de son espace chérifien, celui de la cohérence, de la paix et du rayonnement. Une fédération Maroc–Mauritanie serait non pas un retour en arrière, mais une renaissance d’un partenariat civilisationnel d’égal à égal, où chaque État conserve son indépendance tout en partageant une destinée commune. Elle réconcilierait l’histoire et la géopolitique, l’Afrique et sa mémoire, le présent et le futur.
Et, si l’avenir politique le permet, cette fédération pourrait s’ouvrir à d’autres régions du Maghreb, prêtes à y adhérer dans le respect des valeurs fondatrices : la souveraineté, la modération, la fraternité et la fidélité à l’héritage spirituel et historique de la région.
« Dans un monde où les nations cherchent à redevenir elles-mêmes, le Maroc et la Mauritanie n’ont qu’à s’unir dans ce qu’elles n’ont jamais cessé́ d’être : deux peuples frères, souverains et plus forts ensemble. »