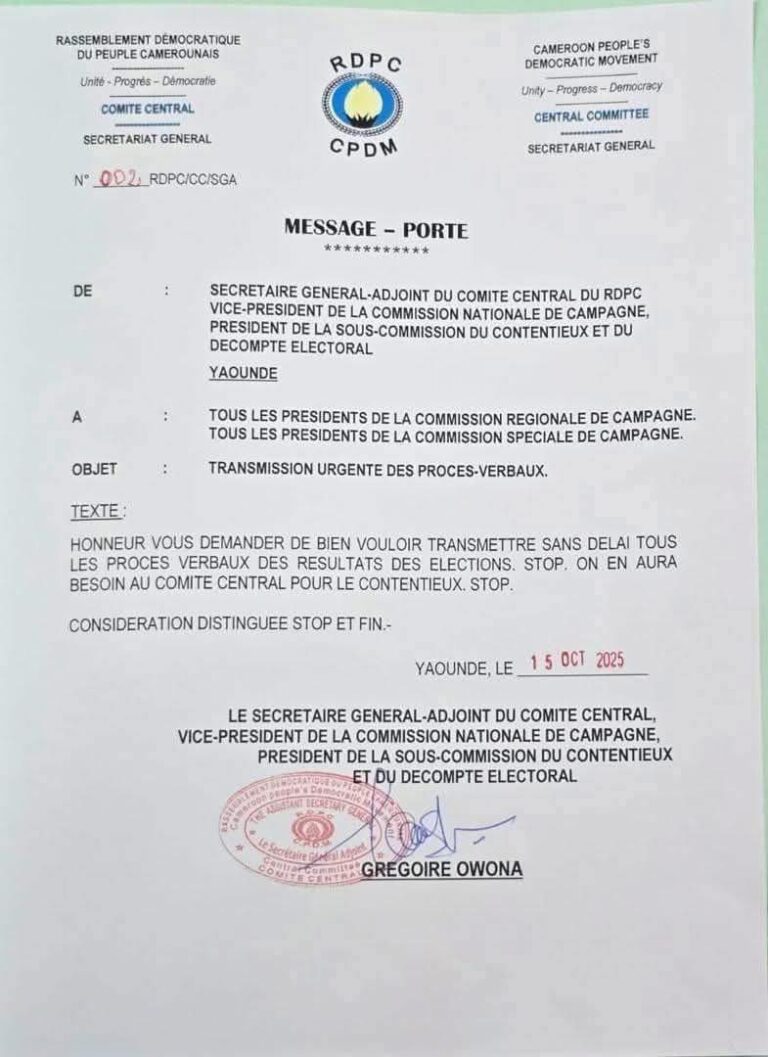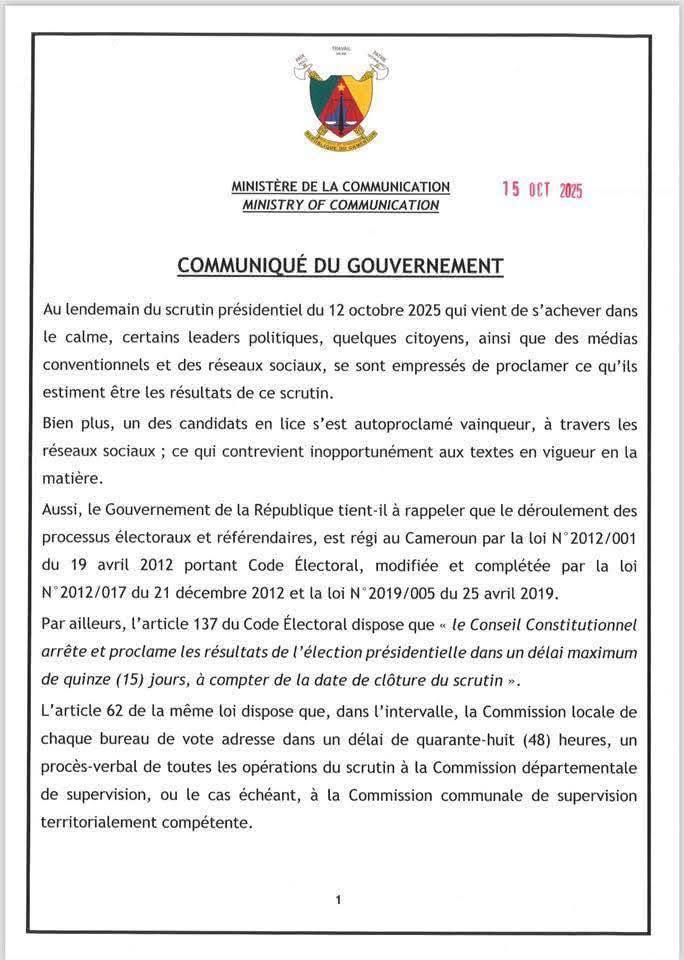C’est au premier étage de la caserne centrale de la Médina de Tunis, celle d’El Attarine, que sont mis en place les films et installations visuelles les plus engagés. Des salles immenses totalement remises à neuf, abritant des œuvres percutantes, passionnantes et qui tournent en boucle et au quotidien depuis le 3 jusqu’au 19 octobre, de 10h00 jusqu’à 18h00. Parmi ces projections, les prouesses visuelles de la « Sharjah Art Foundation ». Cette collection a trouvé son ancrage dans la cité arabe de Tunis, le temps d’une édition de « Dream City ».
Le film explore le paradoxe entre proximité et distance, et la façon dont les événements internationaux peuvent nous toucher intimement tout en étant loin. Tourné depuis Berlin, le long métrage s’ouvre sur des prises aériennes de Gaza et ses architectures détruites. Une voix froide et distante introduit un jeu inventé par un collectif anonyme pour tromper l’ennui : mesurer des distances, d’abord entre des objets, puis entre des villes. L’œuvre interroge l’héritage colonial à travers les frontières, la mémoire et des cartographies abstraites. « We Began by Measuring Distance » a été primé à la Biennale de Sharjah en 2009.
Avec de l’humour satirique, le film interroge l’image irréprochable de la Norvège, celle qui reflète la paix. De 1948 aux Accords d’Oslo de 1993, la chronologie déroule les événements, conflits et massacres en Palestine, ponctués des récits et mythes historiques lus par des enfants, de voix off et de discours politiques. Ce récit en strates met en lumière le modèle norvégien de médiation, en révélant ses limites. Entre images du monde et réalités politiques, se dessine un rêve national confronté à ses propres contradictions.
Dans cette création vidéo, Jumana Manna et Sille Storihle mêlent leurs pratiques pour examiner la construction de l’identité et les dynamiques de pouvoir. L’artiste palestinien Sharif Waked mêle dans son travail la politique contemporaine et l’histoire, détournant les codes esthétiques et la propagande pour en révéler, avec humour, les absurdités.
« To Be Continued… » installe un dispositif familier : celui des enregistrements réalisés par des kamikazes avant leur attaque. Face caméra, un homme — interprété par l’acteur palestinien Saleh Bakri — est assis, un fusil à ses côtés, un livre dans les mains. Mais au lieu d’un message idéologique, il lit un extrait des « Mille et une nuits », où Shéhérazade raconte chaque soir une histoire au roi pour retarder sa mise à mort.
Ce parallèle inattendu interroge le lien entre récit et survie, offrant une critique subtile de la représentation médiatique du martyre et de la résistance. Ici, l’acte de raconter devient geste de vie et de défi, au-delà de tout instrument politique. Raeda Saadeh explore la manière dont la féminité se mêle aux courants sociopolitiques et aux normes culturelles, en partant de son vécu de femme palestinienne, broyé à la fois par l’occupation israélienne et par les conventions religieuses et sociales arabes. Dans « Vacuum », une femme apparaît, aspirateur à la main, nettoyant les collines arides de Palestine, avançant lentement vers la caméra fixe, tandis que le bourdonnement mécanique se mêle au souffle du vent. En plaçant cette tâche domestique banale dans un décor absurde, Saadeh pointe notre acharnement par des gestes vides. Comme il est vain de “nettoyer” une montagne de la poussière et des pierres qui la composent, il est impossible d’effacer la mémoire d’un peuple de sa terre. Tournée entre Jéricho et la mer Morte, cette vidéo sisyphéenne devient métaphore de l’effort quotidien pour survivre et celle de la lutte, sans fin pour la libération.
« Ce qui se passe aujourd’hui en Palestine est un génocide. Le génocide, tel que nous le comprenons, n’est pas un événement isolé, mais un processus qui se déploie à différentes échelles, dans le temps et l’espace, avec des rythmes et des intensités variés. Son but est clair : éliminer tout un peuple, détruire sa culture, l’expulser de ses terres et supprimer son mode de vie ancestral ».
Le projet « What Everybody Knows » s’inscrit dans ce processus. Même si 17 ans séparent les faits documentés dans cette œuvre des atrocités actuelles, les situations analysées à l’époque doivent être vues comme des étapes de ce même processus génocidaire. Partager ce travail, c’est participer à une lutte contre l’oubli.