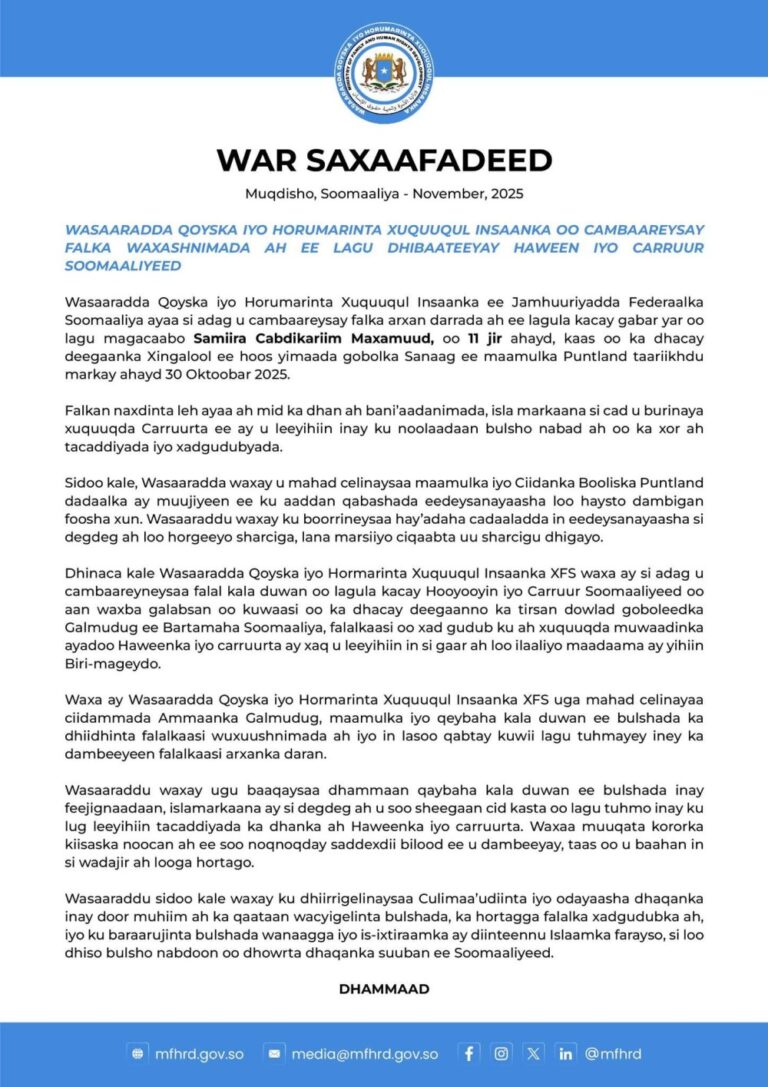Par Mohamed K. – Dans un contexte où certains responsables politiques français zélés font des accords algéro-français de 1968 un symbole commode pour nourrir les peurs et les tensions identitaires, une déclaration de Philippe de Villiers vient rappeler une vérité jusque-là occultée. En en fait, apprend-on, ces accords, dont on sait qu’ils n’étaient pas une faveur faite à l’Algérie, se voulaient un outil souhaité par le patronat français pour répondre à ses besoins économiques et fructifier ses affaires.
«J’ai très bien connu deux personnages importants de la vie politique, Michel Debré qui était un ami personnel, et François Seyrac, patron du Conseil national du patronat français (CNPF) à l’époque. Et les deux m’ont dit la même chose : les accords de 1968, c’est le patronat qui les a réclamés auprès de Georges Pompidou pour pouvoir avoir des travailleurs pas chers et remplacer les travailleurs français trop chers, à cause des syndicats», a révélé Philippe de Villiers. « La gauche généreuse, la gauche qui aime tellement les pauvres, s’efforce d’en faire davantage de peur d’en manquer. C’est ça, l’histoire de la gauche», a-t-il ironisé sut un plateau de télévision française.
Derrière cette révélation se dessine une réalité historique, à savoir que l’immigration algérienne post-1962 a d’abord été encouragée par les milieux économiques français, bien avant d’être instrumentalisée par la gauche ou la droite à des fins bassement électoralistes.
Depuis plusieurs années, ce texte est devenu un épouvantail politique. D’anciens diplomates comme Xavier Driencourt, ex-ambassadeur de France à Alger, ainsi que des figures de la droite et de l’extrême droite, Eric Ciotti, Bruno Retailleau et autre Marine Le Pen, réclament ouvertement son abrogation en en faisant une lecture déformée, relayée dans les médias. Ces nostalgiques de l’Algérie française occultant volontairement le fait que les accords de 1968 ont été progressivement vidés de leur substance par plusieurs avenants et qu’ils ne confèrent plus aujourd’hui aucun avantage particulier. Ils transforment un texte historique, désormais largement obsolète, en arme politique contre l’Algérie et contre la communauté algérienne en France.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a d’ailleurs lui-même relativisé l’importance actuelle de ces accords, le qualifiant de «coquille vide». «Ils ne produisent plus les effets qu’ils avaient à l’origine. Ils ont été vidés de leur substance», a-t-il déclaré, soulignant que les réalités des mobilités et des relations bilatérales ont profondément évolué.
La virulence des prises de position de Ciotti, Retailleau ou Le Pen sur les accords de 1968 n’a que peu à voir avec la rigueur juridique ou diplomatique. Elle relève d’une rhétorique électoraliste, où tout lien avec l’Algérie devient prétexte à rejouer le vieux récit de la «culpabilité postcoloniale» et à flatter les peurs identitaires.
Ces responsables politiques se gardent bien de rappeler que la main-d’œuvre algérienne a contribué de manière décisive à la reconstruction et à la prospérité économique de la France d’après-guerre. Une réalité que Philippe de Villiers, dont on ne peut pas dire pourtant que lui, le mentor du très algérophobe Bruno Retailleau, nourrit quelque bienveillance envers les Algériens, met en lumière en soulignant l’origine patronale de ces accords qui font couler plus d’encre qu’il n’en faut de l’autre côté de la Méditerranée.
Réduire ces derniers à un privilège migratoire est une erreur historique et une faute politique. Ce texte, qui visait à encadrer un flux de main-d’œuvre à un moment précis de l’histoire, n’est plus aujourd’hui qu’un vestige administratif. Le transformer en symbole de la supposée complaisance de la France envers l’Algérie relève d’une instrumentalisation éminemment idéologique.
En rappelant que ces accords sont nés d’une demande du patronat français, Philippe de Villiers, malgré sa critique virulente de la gauche, contribue involontairement à démonter la rhétorique de ceux qui, comme Driencourt, Ciotti, Retailleau ou Le Pen, réécrivent l’histoire pour en faire un argument électoral égoïste.
Le véritable enjeu ne réside ni dans la nostalgie ni dans la crainte, mais dans la faculté de la France institutionnelle, minée par les scandales et conduite par des dirigeants mus par la soif de pouvoir et l’attrait des privilèges attachés aux hautes fonctions, à transcender les caricatures afin d’édifier une relation avec l’Algérie, exempte de la provocation, de la condescendance et de la surenchère.
M. K.